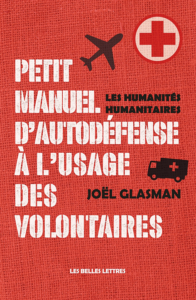La Haine qu’il faut
Paul Salvanès
Les Éditions du Toucan, 2018
Et pourtant cela commençait mal. D’abord on n’échappe pas – classique du genre – à l’incontournable romance entre l’humanitaire et la photographe. Heureusement, l’idylle tourne vite court, preuve qu’elle ne servait pas à grand-chose. Ensuite, on enrage contre l’éditeur qui, à force de coquilles non repérées ou de maladresses négligées, ne rend pas hommage au travail de son auteur : Paul Salvanès a du style et le talent de ne pas en abuser. Cela aurait mérité un meilleur travail de relecture. Enfin – mais c’était peut-être l’obstacle le plus important –, Salvanès s’engageait ainsi dans un genre bien plus complexe qu’il n’y paraît : pour romanesque qu’il soit, l’humanitaire donne rarement naissance à de bons romans. Il en va ainsi de tous les thèmes a priori dotés de ressorts naturels – de la guerre au sport, en passant par la politique – qui, entre des mains peu expertes, tombent à plat à force d’être investis sans imagination, au ras des pâquerettes de clichés activés à tour de bras. Et pour son premier roman, Paul Salvanès s’en sort très bien, franchissant adroitement cet obstacle majeur et reléguant au rang de pêchés véniels nos deux premières réserves.
L’histoire n’a rien d’original… et c’est une excellente chose car, ce faisant, l’auteur la situe à hauteur d’homme, au plus près de la réalité que rencontrent les ONG et des nouveaux profils qui se présentent à leurs portes. Bosco, 25 ans, fraîchement diplômé d’un Master 2 en Relations internationales, s’est engagé dans l’humanitaire. Première mission au Darfour : là, il fait ses gammes et ses preuves, trouve le « sens qui, jusque-là, manquait à la vie terne dont il s’est arraché ». Le temps d’un séjour à Paris où il rumine l’adrénaline dont il a été trop vite sevré (« Il imaginait sa vie ici, loin de l’action, comme une gare de campagne où les trains ne passent plus »), puis il repart en République démocratique du Congo. C’est à Goma qu’un assassinat d’expatrié, commis quelques mois plus tôt quand il était au Soudan, lui semble prendre une dimension nouvelle, plus inquiétante encore : un autre meurtre croise sa route. Un fétiche africain retrouvé à proximité de ces cadavres achève de convaincre Bosco qu’il tient la piste d’un tueur en série. Car Salvanès a entrepris de faire de son roman un polar et de son jeune humanitaire un enquêteur.
Et à vrai dire, on n’y croit pas tout de suite – et cela nous tient assez longtemps – parce que Bosco y croit trop vite. Mais Salvanès a aussi ce talent d’ouvrir des voies martyres qu’il dynamite une à une. Une première piste s’épuise, tout comme la deuxième, jusqu’au dénouement inattendu dont la belle maîtrise qu’en a l’auteur nous récompense de notre (im)patience incrédule.
Et en attendant ce final réussi, le lecteur avance avec plaisir dans ce roman. S’il est néophyte, il apprendra beaucoup de choses sur le milieu de l’humanitaire, ses protocoles, sa sociologie ou encore ses réunions au cours desquelles se jaugent membres d’ONG en recherche de financements et bailleurs tout puissants. S’il « en est », il trouvera là une belle source de réflexion : sur l’engagement, le renouvellement générationnel que connaît le secteur, et les désillusions qui peuvent ravager des personnalités borderline. Car si l’enfer est pavé de bonnes intentions, l’humanitaire demeure du monde de l’imparfait. Une vérité que Paul Salvanès met bien en lumière, évitant les écueils de l’héroïsation facile et de l’entre-soi. Il parvient à intéresser tous les publics et apporte un soin particulier à faire entendre aussi bien la voix du « milieu » – par l’intermédiaire de Bosco – que celle des témoins souvent silencieux : il en va ainsi de Kambale, l’enfant-soldat, symbole et miroir de logiques implacables contre lesquelles les humanitaires se révèlent impuissants.