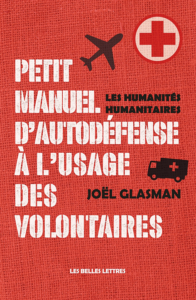Martín Caparrós •

Un livre de Martín Caparrós
Traduit de l’espagnol (Argentine)
par Alexandra Carrasco
Buchet/Chastel,
781 pages | 2015
Le mot de l’éditeur
« 25 000 hommes, femmes, enfants meurent chaque jour de faim ou de malnutrition à travers le monde. Aucun fléau, aucune épidémie, aucune guerre n’a jamais, dans toute l’histoire de l’humanité, exigé un tel tribut. Et pourtant, la nourriture ne manque pas : la planète ploie sous l’effet de la surproduction alimentaire et le négoce va bon train. Comment documenter ce paradoxe sans tomber dans la vaine accumulation statistique ? C’est la question qu’explore Martín Caparrós en partant à la rencontre de ceux qui ont faim, mais aussi de ceux qui s’enrichissent et gaspillent à force d’être repus. Leurs histoires sont là, rendues avec empathie et perspicacité par l’auteur. Fouillant sans relâche les mécanismes qui privent les uns de ce processus essentiel, manger, alors que les autres meurent d’ingurgiter à l’excès, le texte livre une réflexion éclairante sur la faim dans le monde et ses enjeux, du Niger au Bangladesh, du Soudan à Madagascar, des États-Unis à l’Argentine, de l’Inde à l’Espagne. Un état des lieux implacable et nécessaire. »
Alternatives Humanitaires — Qu’est-ce qui, dans votre itinéraire personnel et votre réflexion d’auteur et de journaliste, vous a amené à consacrer un livre aussi fouillé et ambitieux à la question de la faim ?
Martín Caparrós — J’ai passé près de trente ans à travailler sur des sujets sociaux. J’ai fait des reportages un peu partout dans le monde sur les problèmes de guerre ou de migration. Et je voyais que, en général, derrière tous ces problèmes il y avait une sorte de constante : des gens ne mangeaient pas à leur faim. Pendant longtemps, je n’ai pas su comment j’allais pouvoir traiter ce sujet, souvent perçu comme un cliché, sur lequel on pense tout savoir alors qu’on ne veut pas trop savoir justement. Le déclencheur, ce fut lorsque j’ai lu quelque part que l’on était devenu capable de nourrir tous les habitants de la planète après une longue période pendant laquelle on n’a pas pu le faire. Cela veut dire que la faim n’est pas due aujourd’hui à des données techniques de production, mais que c’est un problème politique, économique, social. Je me suis dit alors que j’allais procéder comme j’ai l’habitude de le faire quand j’affronte ce genre de travail : en allant écouter les gens qui sont concernés. En général, à propos de la faim, on parle de chiffres, on montre toujours les mêmes images, à tel point qu’on finit par rendre tout cela abstrait. Et c’est sur la base de cette construction abstraite qu’on pense savoir tout ce qu’il y a à savoir. Or je me suis dit une chose très simple : la faim n’existe pas. Ce qui existe, ce sont des millions de personnes qui ne mangent pas et je voulais écouter leur histoire, du moins celle de certaines d’entre elles, en allant là où elles vivent, ou survivent, pour tenter de comprendre à travers elles les différents mécanismes, les multiples structures de la faim. C’est un travail qui m’a pris quatre ou cinq années.
A. H. — Dans votre livre, une phrase m’a interpellé : « J’ai toujours imaginé que je commencerais ce livre par le récit cru, déchirant, féroce d’une famine. Je débarquerais avec un convoi d’urgence dans une contrée sinistre, probablement en Afrique, où des milliers de personnes seraient en train de mourir de faim. » Et puis, un peu plus loin, vous dites : « J’avais tout parfaitement pesé, conçu, mais durant les années où j’ai travaillé sur ce livre, aucune famine gigantesque n’a sévi, rien sinon la faim routinière… ». Cela m’a aussitôt fait penser au livre « Équipée » de Victor Segalen, dans lequel il imagine avant de s’y rendre la ville de Chengdu, dans le Sud-Ouest de la Chine, en se demandant si l’imaginaire se renforce ou décroît au contact de la réalité. Je me suis posé la même question pour votre livre : qu’est-ce que vous imaginiez de la faim avant d’écrire ce livre et qu’est-ce que vous avez découvert ?
M. C. — Comme pour beaucoup d’entre nous, la faim, c’étaient ces images que je voyais enfant, ces autres enfants du Biafra, au ventre gonflé, etc. Je m’imaginais donc arrivant dans un endroit où les gens seraient étendus sans nourriture, comme sur un étrange champ de bataille. Et j’ai vite appris que ce n’est plus le cas, que les famines sont de nos jours plus ou moins contrôlées. Mais cela fait que la faim contemporaine est bien plus difficile à montrer. Parce que l’on n’a plus, ou moins, ces images troublantes, cela fait de la faim quelque chose de beaucoup plus souterrain, de plus sourd. Il faut creuser davantage pour arriver à montrer comment ça se passe. Il faut savoir par exemple que l’on compte environ un milliard et demi de personnes qui sont à la marge du système global. Des décennies de changements techniques et sociaux ont marginalisé ces populations, que l’on retrouve aux alentours des grandes villes, et c’est parmi elles, bien sûr, que l’on trouve la plupart des affamés. C’est une mise en évidence de la faillite du système qui n’est pas capable d’intégrer cette force de travail, cette ressource que représentent ces gens.
A. H. — Vous avez donc rencontré des personnes souffrant de la faim. Comment, en tant que journaliste, en tant que personne tout simplement bien nourrie, on vit cette expérience de parler avec quelqu’un qui est dans cette situation ?
M. C. — Il y avait toujours de l’inquiétude de ma part, mais cela dépendait beaucoup de la manière dont la personne avec qui j’étais en train de parler ressentait sa propre situation. Mais il y a quelque chose qui modère un peu ce déséquilibre, c’est que la plupart des personnes sentaient bien que j’étais là pour les écouter, alors que ce n’était pas très habituel pour elles. De mon côté, j’étais d’autant plus ému et heureux qu’elles acceptent. Cela a donné lieu à des échanges souvent très intenses. Je pense à Fatema, une femme bangladaise, qui travaillait dans une usine de textile à Dacca pour payer la maison et la nourriture de ses enfants. Elle me racontait sa vie très difficile, les dix ou douze heures qu’elle passait chaque jour devant sa machine, mais elle me disait qu’elle aimait quand même cette usine parce qu’elle pouvait parler avec d’autres femmes. Quand je lui ai demandé ce qui la dérangeait le plus dans son travail, elle m’a répondu que c’était de penser tout le temps à son mari qui était parti, la laissant toute seule avec les enfants. Et quand je lui ai demandé si elle voudrait qu’il revienne, alors qu’elle l’avait traité de tous les noms quelques instants plus tôt, elle a rougi avant d’admettre timidement qu’elle aimerait bien. Tout d’un coup, cette femme solide, qui travaille, se bat pour ses enfants, montrait de la fragilité…
A. H. — Sans pour autant parler de la faim qu’elle éprouvait car, avec ce qui lui reste, vous dites que c’est « au mieux, du riz deux fois par jour ». Vous ajoutez : « On pense généralement la faim comme un problème qui touche ceux qui n’ont pas de travail, les marginaux, les perdus ; pas ceux qui passent la moitié de leur vie devant une machine à produire des marchandises prisées. » Cette histoire est intéressante parce qu’elle dépasse les clichés sur la faim. Vous parlez là d’une femme qui travaille, certes dans les conditions difficiles que l’on connaît de l’industrie textile au Bangladesh, mais qui est d’une certaine manière « intégrée » au système…
M. C. — J’ai choisi chacun des pays où je suis allé parce qu’ils me permettaient d’illustrer les différentes mécaniques de la faim. Le Bangladesh m’offrait de montrer comment la faim est encore utilisée par certains patrons comme un instrument de contrôle. Le fait que toutes ces femmes comme Fatema supportent de travailler douze heures par jour, six jours par semaine, pour un salaire mensuel de 3 000 takas (35 euros), ne peut s’expliquer que par la faim mais, même en travaillant, elle continue à ne pas manger assez, et si elle ne travaillait pas, ce serait la mort. Cette instrumentalisation de la faim n’est pas seulement un effet secondaire d’une politique locale ou d’une économie mondiale, c’est aussi une arme que certains patrons utilisent pour obtenir encore plus de bénéfices.
A. H. — À l’occasion de ce livre, vous avez été amené, je crois, à rencontrer des ONG. Que retirez-vous de cette rencontre, à la fois sur la question de la malnutrition et, plus généralement, de leur action ?
M. C. — Oui, j’ai beaucoup travaillé avec les ONG, notamment Médecins Sans Frontières. Quand j’ai commencé à penser au livre, je suis tout de suite entré en contact avec certains membres de MSF que je connaissais déjà. Et ils ont été d’une aide inestimable parce que, pour quatre ou cinq pays où je suis allé pour cet ouvrage, j’ai pu me rendre sur leurs missions. Ils m’ont permis de rentrer en contact avec des personnes que j’ai pu interviewer. Et comme j’ai aussi habité dans leurs maisons, j’ai eu l’occasion de voir les humanitaires dans leur fonctionnement quotidien. D’un côté, je respecte leur engagement pour, comme ils le répètent vingt fois par jour, « sauver des vies ». C’est beau, c’est « remplissant » ce sentiment. D’un autre côté, je m’interroge – et je sais qu’eux aussi – sur le fait que ce n’est pas une solution sur le long terme et qu’il faudrait être capable d’agir sur les causes. Ils savent qu’ils n’en ont souvent pas la possibilité, alors ils se contentent d’agir sur les conséquences. Et ils le font de façon assez efficace.
A. H. — Cela renvoie à l’éternel débat entre le fait de savoir si les ONG forment le dernier rempart face à certains drames – elles font ce qu’elles peuvent, mais ne peuvent agir sur les causes – ou si, par certains aspects, elles ne seraient pas amenées malgré elles à entretenir un système inique.
M. C. — En tout cas, je ne crois pas à ce vieux principe d’inspiration trotskiste qui voudrait que, par certains côtés, en laissant faire le pire on obtienne le meilleur. Ce n’est donc certainement pas en laissant mourir des milliers de personnes qu’on résoudra la question de la faim dans le monde. Plus globalement, il ne me semble pas que les révoltes, plus ou moins importantes, arrivent au pire moment, quand la situation est désespérée. Elles surviennent quand existe le minimum pour que les gens puissent penser, non pas seulement à ce qu’ils vont manger le soir, mais à la manière dont ils vont manger dans les années à venir, quand ils ont encore la capacité de se projeter et de se rassembler. Le problème est de savoir si les ONG se limitent à mettre des pansements sur une hémorragie ou si elles aident les personnes à atteindre ce minimum sans lequel aucune révolte, aucun changement n’est possible.
Propos recueillis par Boris Martin, rédacteur en chef
Pour lire l’article en PDF cliquez ici.