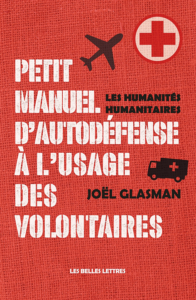Entretien avec Marc Le Pape
 En qualité de sociologue, Marc Le Pape a effectué des recherches en Algérie, en Côte d’Ivoire et en Afrique centrale. Ses travaux récents portent sur les conflits dans la région des Grands Lacs africains. Il a co-dirigé plusieurs ouvrages comme Côte d’Ivoire, l’année terrible 1999-2000 (avec Claudine Vidal, Karthala, 2003), Crises extrêmes (avec Johanna Siméant et Claudine Vidal, La Découverte, 2006) et, dans le cadre de Médecins Sans Frontières, Une guerre contre les civils. Réflexions sur les pratiques humanitaires au Congo-Brazzaville, 1998-2000 (avec Pierre Salignon, Karthala, 2001). Marc Le Pape a été chercheur au CNRS, il est actuellement chercheur associé à l’Ehess (Centre d’études africaines). Il vient de faire paraître, avec Jean-Hervé Bradol du Crash (Centre de réflexion sur l’action et les savoirs humanitaires), un ouvrage revenant sur le génocide des Tutsis du Rwanda à partir des archives de Médecins Sans Frontières.
En qualité de sociologue, Marc Le Pape a effectué des recherches en Algérie, en Côte d’Ivoire et en Afrique centrale. Ses travaux récents portent sur les conflits dans la région des Grands Lacs africains. Il a co-dirigé plusieurs ouvrages comme Côte d’Ivoire, l’année terrible 1999-2000 (avec Claudine Vidal, Karthala, 2003), Crises extrêmes (avec Johanna Siméant et Claudine Vidal, La Découverte, 2006) et, dans le cadre de Médecins Sans Frontières, Une guerre contre les civils. Réflexions sur les pratiques humanitaires au Congo-Brazzaville, 1998-2000 (avec Pierre Salignon, Karthala, 2001). Marc Le Pape a été chercheur au CNRS, il est actuellement chercheur associé à l’Ehess (Centre d’études africaines). Il vient de faire paraître, avec Jean-Hervé Bradol du Crash (Centre de réflexion sur l’action et les savoirs humanitaires), un ouvrage revenant sur le génocide des Tutsis du Rwanda à partir des archives de Médecins Sans Frontières.
Alternatives Humanitaires — Ce livre paraît presque 23 ans après le génocide des Tutsis au Rwanda, quel en a été le déclencheur ?
Marc Le Pape — Quelque temps avant le 20e anniversaire du génocide des Tutsis, en 2014, nous nous disions avec Jean-Hervé Bradol que des questions nous seraient certainement posées – par des journalistes, ou plus généralement des personnes intéressées au sujet – pour savoir ce que Médecins Sans Frontières (MSF) avait précisément fait et vu à l’époque. Et pour nous, il était évident qu’on ne serait pas en mesure de répondre de manière vraiment circonstanciée. Jean-Hervé admettait lui-même ne pas avoir de vue globale des événements ni de l’action de l’ensemble du mouvement MSF, alors qu’il était sur le terrain. D’une certaine manière, cela nous a incités à en savoir plus. Par ailleurs, nous avions quelques raisons plus personnelles de vouloir comprendre ce qu’avait été l’expérience de MSF, non seulement pendant les cent jours du génocide lui-même à l’intérieur du Rwanda, mais aussi dans les années l’ayant précédé et suivi, notamment entre 1994 et 1997, dans les grands camps de réfugiés du Zaïre [actuelle République démocratique du Congo, NDLR] ou de Tanzanie. De son côté, donc, Jean-Hervé était au Rwanda quand le génocide a commencé et ce fut, bien sûr, une expérience assez rude qui l’a marqué. En ce qui me concerne, j’étais déjà allé au Rwanda, j’avais des amis rwandais et ma compagne Claudine Vidal est sociologue et spécialiste de ce pays, si bien qu’on en parlait beaucoup. Et dès le début du génocide, nous avions des nouvelles terribles sur ce qui se passait, sur le caractère systématique des exécutions et nous apprenions régulièrement la mort de Tutsis que Claudine connaissait pour avoir travaillé avec eux des années plus tôt.
A. H. — La particularité du livre est de s’appuyer sur les archives de MSF. Pourquoi cette démarche et qu’avez-vous trouvé d’original ou d’inédit dans ces archives ?
M. L. P. — Nous pensions que ce qui était le plus méconnu dans l’action de MSF, c’était le travail des équipes de terrain : comment elles analysaient les situations et intervenaient, quelles négociations elles pouvaient conduire avec les autorités et quelles pratiques de secours elles arrivaient à déployer, et de quelle manière. Car si MSF est connue publiquement pour ses prises de parole critiques, le grand public comme les spécialistes d’ailleurs n’ont qu’une vague idée de ce que représente le travail de terrain dans ce genre de situation. C’est pour cela que nous avons décidé de mettre l’accent sur les messages qui venaient du terrain et c’est la vraie originalité de cette démarche par rapport à la plupart des ouvrages écrits jusqu’à présent qui s’intéressent beaucoup plus au niveau macropolitique, macrohumanitaire ou au rôle du Tribunal pénal international pour le Rwanda par exemple. Ce niveau « micro » nous a permis d’observer les opérations dans la durée de leur évolution : comment on décide de les maintenir ou de les arrêter.
On s’est aussi intéressé au rapport entre ces terrains, les capitales nationales et les sièges des différentes sections MSF. Si bien que si l’on a étudié ce qui circulait du terrain vers le haut, on a aussi observé la manière dont les sièges de l’association réagissaient à tous ces messages qui arrivaient du terrain : quels genres de communiqués de presse étaient rédigés et, en retour, comment le terrain réagissait à ces communiqués de presse. C’est à mon sens un des apports originaux de ce travail et qui n’avait pas été versé jusqu’alors dans le domaine public : grâce aux archives, on voit comment les discours du terrain sont transformés par le siège dans sa communication parce que celui-ci le juge comme politiquement opportun, et comment le terrain réagit, soit en « protégeant » le siège parce qu’il estime que ça fait avancer les choses, soit en s’opposant à lui parce qu’il considère que sa prise de position le met en difficulté, voire en danger.
A. H. — Qu’est-ce qui vous a le plus surpris dans ces relations entre le terrain et les sièges ?
M. L. P. — Vous faites bien de préciser « les sièges », car les sections hollandaise, belge et française étaient aussi impliquées les unes que les autres pendant toute cette période, et même pendant les sept années de 1990 à 1997 qui sont celles pour lesquelles nous avions le plus de matière. On a retrouvé les correspondances de Paris avec la Hollande et Bruxelles et cela allait dans le sens de notre intention, à savoir ne pas restituer le seul point de vue de la section française – « l’historique » –, au risque de la glorifier par rapport aux autres. Non, nous avons essayé de construire un récit qui ne prenne pas parti.
Pour répondre maintenant et directement à la question, je dirais que cela dépend des moments et des situations, même si la période du génocide proprement dit est évidemment très particulière. Et Jean-Hervé n’aurait sûrement pas la même réponse que moi. Mais en ce qui me concerne, ce qui m’a sans doute le plus surpris, c’est l’importance extraordinaire – et le temps – accordés au dénombrement des populations : celles des camps, celles en fuite, celles victimes, mortes ou blessées… Il y avait une obsession du dénombrement, évidemment justifiée pour des raisons médicales et politiques. Médicales parce qu’il fallait savoir quels genres de pathologies soigner, quels stocks de nourriture apporter, etc. Mais aussi politiques car il était important, pour étayer les témoignages, de savoir combien de gens avaient été massacrés, combien étaient en fuite. Rappelons-nous de la polémique au début de la destruction des camps du Zaïre en 1996 : le Rwanda et son allié américain affirmaient que tous les réfugiés étaient rentrés si bien qu’on pouvait détruire les camps du Kivu. Or il est apparu que si environ 600 000 réfugiés étaient bien rentrés, il en restait quelque 400 000 dans la nature qu’il fallait bien protéger. C’est dire si les chiffres étaient immédiatement transformés en argumentaire politique par les différents protagonistes. Pour MSF, ce souci d’avoir des chiffres les plus précis possible s’expliquait par la nécessité d’avoir du poids dans les prises de position publiques, dans les communiqués de presse, dans les interventions aux Nations unies, au Conseil de sécurité par exemple.
A. H. — Une abondante littérature a tenté d’expliquer les signes précurseurs, dans l’histoire du Rwanda et plus largement des Grands Lacs, de ce génocide. La force de votre livre est aussi, sur la base des archives et donc de la présence de MSF, de remonter jusqu’en 1982. Est-ce que vous y avez vu des éléments qui pouvaient laisser présager ce qui allait se passer ?
M. L. P. — Pas à cette échelle-là. En 1993, après l’assassinat de Melchior Ndadaye, le premier président hutu du Burundi, beaucoup de Burundais ont fui pour se réfugier dans des camps au Rwanda où MSF travaillait déjà auprès de Rwandais hutus fuyant l’offensive du Front patriotique rwandais (FPR) qui n’hésitait pas à organiser des massacres que MSF a d’ailleurs relevés. Et je crois que c’est à partir de ce moment-là que l’ONG s’est dit que quelque chose de plus dramatique encore pouvait arriver. En 1993-1994, des mesures ont été d’ailleurs prises à l’hôpital de Kigali en prévision d’une catastrophe importante : on parlait éventuellement de massacres de populations tutsies, mais pas d’un programme systématique à l’échelle de tout le pays. MSF en tout cas n’avait vraiment pas perçu ça. Il faut dire qu’elle avait encore – et elle n’était pas seule – une lecture plutôt ethniciste de ce qui pouvait se passer en Afrique, fruit d’une anthropologie un peu ancienne, culturaliste où tout était interprété en termes de conflit ethnique. Or, en ayant une telle lecture, il était précisément impossible d’imaginer ce génocide tel qu’il s’est déroulé, c’est-à-dire selon un plan global, très précis et ultra-politique.
A. H. — On a eu des témoignages d’ONG qui faisaient état d’une déconnexion entre les sièges et les terrains, ces derniers se sentant désarmés et demandant des instructions aux sièges qui ne prenaient pas, en tout cas au début du génocide, la mesure de ce qui se passait. Est-ce quelque chose qui s’est produit à MSF ?
M. L. P. — Jean-Hervé serait sans doute plus à même de répondre sur ce point puisqu’il était à l’époque soit sur le terrain, soit responsable de « desk » au siège. Quant à moi, j’ai surtout axé mes recherches sur l’après-génocide, les camps et l’histoire du Zaïre de l’époque. Mais c’est vrai que j’ai aussi lu des témoignages en ce sens. Du côté de MSF, on n’a pas noté cette déconnexion : les messages de Jean-Hervé étaient suivis, parce qu’il a perçu assez vite ce qui se passait. Avec d’autres évidemment, et pas seulement de MSF : je pense à Philippe Gaillard du CICR notamment. Tous deux ont bien compris que ce n’était pas le chaos, mais qu’il y avait vraiment une administration, un État, des militaires, une hiérarchie de commandement et tout cela fonctionnait pour mettre en œuvre le génocide. Ces deux personnalités étaient suivies par leurs sièges respectifs, comme en témoignent les communiqués de presse émis à l’époque, repris dans de nombreux journaux européens.
A. H. — Et après le génocide lui-même, après la fuite des Hutus, les représailles du régime rwandais, la situation dans les camps du Kivu, qu’est-ce qu’on apprend des archives MSF ?
M. L. P. — On apprend le travail qui est fait, en coopération avec d’autres ONG, pour savoir par quelles autorités il est possible de passer pour apporter de l’aide. Comme je le disais, on a alors vu au moins 400 000 réfugiés rwandais arriver en quelques jours dans le nord Kivu, autour de Goma, de surcroît avec une épidémie de choléra qui s’est presque aussitôt déclenchée. Tout le monde se demande comment organiser une réponse dans de telles conditions, tout en essayant de comprendre ce qui se passe, à savoir que les autorités génocidaires sont parmi ces réfugiés, avec leurs groupes et leurs réseaux d’activistes.
A. H. — La polémique fait rage à l’époque, dans le milieu humanitaire notamment, car on se dit que les camps sont un endroit qui permet la poursuite des massacres…
M. L. P. — En effet, et il y a une grande division à l’intérieur même du mouvement MSF autour de la question presque « classique » : partir ou rester ? Il n’était pas facile de comprendre, en tout cas de faire comprendre, que sur les 400 000 Rwandais hutus en fuite dans les camps de Goma, tous n’étaient pas des génocidaires, loin de là. C’était même une minorité et là, on retombe sur une autre polémique, à savoir la fuite de tous les Hutus du Rwanda présentée comme s’il y avait eu un ordre général. Dans les faits, beaucoup de personnes qui n’étaient pas impliquées ont fui parce que dans leur village, leurs connaissances, leurs voisins, tout le monde fuyait, poussé par les rumeurs – parfois avérées, parfois inexactes – de massacres perpétrés par le FPR dans le nord du Rwanda. On nourrissait donc aussi et surtout des victimes de cet exode et non une masse de génocidaires, comme certains l’affirmaient. Cependant MSF-France se retira des camps dès novembre 1994 au motif qu’elle ne voulait pas contribuer à renforcer le pouvoir des agents du génocide.
A. H. — Qu’est-ce que, selon vous, ce génocide a apporté comme enseignements aux humanitaires ?
M. L. P. — MSF s’est vraiment interrogée sur sa propre pratique : ce génocide a représenté un vrai ébranlement qui a touché d’ailleurs l’ensemble des praticiens et des organisations de la société humanitaire. Cette histoire nourrit et va continuer de nourrir la recherche parce que c’est un génocide, précisément. C’est une qualification très fréquemment employée pour des massacres mais au Rwanda, il y a eu une dimension systématique de massacres, d’exécutions avec des formes de cruauté très variées et de viols, évidemment. Pour les humanitaires, ce fut une expérience éprouvante d’être confrontés à cela pendant trois mois, d’autant qu’ils ne mesuraient pas toujours ce qui se passait à l’échelle du pays : MSF avait une équipe à Kigali qui voyait ce qui se passait, et pour le reste c’était du bouche à oreille. Les rumeurs ont tenu d’ailleurs une place importante dans ce drame. C’est une chose qui m’a frappé. Je repense à celle qui disait que, dans un hôpital situé dans un camp au Zaïre, des infirmiers avaient un physique considéré comme « tutsi », et que l’hôpital risquait donc d’être attaqué pour tuer les infirmiers tutsis. Que faire de cette rumeur ? qui croire ? Beaucoup de meurtres de présumés Tutsis ont eu lieu sur la base de telles rumeurs, en somme une criminalité dans la continuité directe du génocide, passée presque inaperçue.
Propos recueillis par Boris Martin, rédacteur en chef.
Pour lire l’article en PDF cliquez ici.
ISBN de l’article (HTML): 978-2-37704-250-0