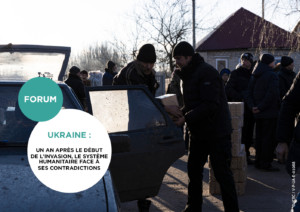Depuis plusieurs années, l’écosystème humanitaire est en pleine transition. C’est même une des raisons d’être de notre revue que d’accompagner cette dernière et de la mettre en débat en invitant ses acteurs comme ses observateurs au dialogue. S’il est un phénomène emblématique de cette évolution, c’est bien l’arrivée du secteur marchand dans un domaine d’activité qui l’avait longtemps tenu à l’écart, comme en marge.
En effet, à côté des acteurs traditionnels, Nations unies et ONG en tête, le secteur privé – qu’il s’agisse des entreprises « classiques » ou de leurs fondations, mais aussi des entreprises sociales – a fait une entrée remarquée dans le champ humanitaire, après avoir fait ses gammes dans le développement ou le social. Cette intervention croissante se manifeste par des actions directes sur le terrain, par des financements ou du « mécénat de compétences ». Plus généralement des pratiques nouvelles émergent (remise directe de cash aux populations, aide délivrée via des réseaux lucratifs – cartes bancaires, téléphones mobiles, drones, etc.) et, au-delà, des logiques managériales inspirées du monde de l’entreprise (« professionnalisation », certification, évaluation, gestion des ressources humaines) s’installent pour transformer indiscutablement le secteur de l’aide.
Certains y voient un risque de confusion quand d’autres saluent une extension du domaine de la lutte au profit des populations vulnérables. Les ONG pourraient en effet désormais compter sur de nouveaux partenaires disposant de compétences, de moyens techniques et de financements qui commencent à leur faire cruellement défaut.
Cette mutation génère encore, et cela est salutaire, nombre de discussions et d’oppositions, parfois symptomatiques d’un choc de cultures entre entreprises et ONG. Et l’on n’en sortira certainement pas en se limitant, comme ce fût trop souvent le cas par le passé, à une opposition stérile.
Le premier enseignement de ce dossier est, sans nul doute, que le sujet a mûri, tout comme ses protagonistes. Délaissant la naïveté ou le refus catégorique, les ONG ont fini par prendre le sujet à bras-le-corps. Comprenant un peu mieux ce milieu qu’elles dénigraient peut-être trop facilement, les entreprises ont pris la mesure des craintes exprimées par « l’autre camp ». Et peut-être aperçoit-on la voie médiane entre dénigrement et défense d’un territoire qui, finalement, n’appartient à personne, sinon aux victimes.
Il serait donc vain pour les ONG de ne pas acter cette évolution, sans pour autant abdiquer leur capacité critique, leur histoire, leurs engagements. L’objectif de ce numéro est de faire un état des lieux et de poser les termes du dialogue qui doit être permanent, ferme mais ouvert entre entreprises et ONG. Le lucratif/non-lucratif est-il encore une frontière pertinente ? Faut-il imposer des limites aux entreprises ? Quel discours de sensibilisation les ONG peuvent-elles porter ? Au final, il s’agit de se demander comment cette addition d’initiatives privées (car les ONG sont aussi des structures privées) peut servir l’intérêt général, celui des populations en souffrance.
Les articles qui composent le Focus de ce numéro couvrent une bonne partie du spectre des opinions que génère cette problématique. Mathieu Dufour l’étrenne de manière on ne peut plus claire en affirmant que les ONG n’ont pas « le monopole des bonnes intentions » et que, tout comme les entreprises lucratives, elles « sont fondamentalement soumises aux mêmes règles de fonctionnement ». Le directeur financier de l’ONG Alima n’hésite pas à déclarer que la non-lucrativité n’est plus un critère pour « estimer l’impact d’intérêt général d’une organisation ». Pointant du doigt la logique actuelle des financements publics et internationaux, l’auteur dénonce l’immixtion des bailleurs dans la définition du modèle financier des associations tout comme dans leur gouvernance. En réponse, il vante les mérites des « contrats à impact social » récemment mis sur pied en France, qui permettent à un investisseur privé de financer un programme de prévention et d’être remboursé, avec intérêts, par la puissance publique en cas de succès. Il relate également le cas de son association qui s’apprête à émettre presque 2 millions d’euros de titres associatifs pour financer sa capacité de réponse opérationnelle. Les temps ont incontestablement changé.
Et c’est bien la même contrainte financière qui a amené l’ONG libanaise arcenciel, il y a plus de 30 ans, à adopter un modèle hybride, mi-entreprise, mi-ONG, pour financer ses activités sociales au pays des cèdres. Créée en pleine guerre civile, dans un environnement politiquement et religieusement fracturé, la jeune association – un peu à l’identique de BRAC la bangladaise – a fait le choix d’un modèle qui perdure : « les activités génératrices de revenus permettent d’assurer le fonctionnement des activités non génératrices de revenus, chacune répondant à un objectif social et/ou environnemental ». Et aujourd’hui, nous dit Kristel Guyon, l’association affiche un budget de 15 millions de dollars, autofinancé à hauteur de 72 %.
À des milliers de kilomètres de Beyrouth, en Équateur, Lucie Laplace nous conte comment, dans ce « pays socialiste du XXIe siècle », l’État favorise l’émergence de politiques d’insertion économique pour aider les populations réfugiées. Le bilan se fait ici plus nuancé, sans doute à la mesure du paradoxe voyant le héraut de la « révolution citoyenne » abandonner les ONG à un face-à-face avec les entreprises « comme alternative au modèle capitaliste libéral ». Cette jeune chercheuse observe comment cette formule semble davantage aboutir à un « dédouanement des responsabilités sociopolitiques des principaux acteurs » sans que les réfugiés ne voient une véritable amélioration de leurs conditions d’existence.
C’est sans doute qu’il faut élargir la focale pour mieux voir les implications de l’arrivée des entreprises dans le champ humanitaire. Isabelle Schlaepfer, chercheuse au Humanitarian and Conflict Response Institute de l’Université de Manchester, le fait en interrogeant les notions de légitimité et de redevabilité depuis l’arrivée des entreprises, notamment dans les programmes de cash transfer. Selon elle, les règles et pratiques du « nouveau managérialisme » posent d’indiscutables problèmes lorsqu’il s’agit de récolter des données privées (adresses, noms, genre, etc.) dans le cadre d’interventions humanitaires. Si les ONG ont conquis leur légitimité et développé leur redevabilité, aussi bien à l’égard des bailleurs que des bénéficiaires, il n’est pas certain que les entreprises en aient fait de même. Il est en tout cas avéré qu’elles voient davantage les bénéficiaires comme des consommateurs, avec toutes les implications d’une telle mutation qui, selon l’auteure, conduit à une sorte de « concurrence » des formes de redevabilité.
Mouvement exponentiel, presque irrépressible, l’arrivée des entreprises dans le champ humanitaire interroge aussi bien l’éthique que la géopolitique. C’est ce que fait Anne-Aël Pohu, juriste et experte indépendante en développement international, ayant collaboré à la Fondation Handicap International en tant qu’analyste éthique. Dans son article sur les « for-profit development companies », elle nous explique comme ces « compagnies privées de développement » (CPD) – créées souvent pour faire exclusivement du développement, voire de l’humanitaire – captent une majorité de financements publics : « le volume de l’aide absorbé par les CPD ne cesse de croître. Leur contractualisation par USAID, l’agence américaine pour le développement international, avait progressivement émergé dans les années 1990 avant de significativement augmenter dans les années 2000, en raison des besoins importants de reconstruction en Irak et en Afghanistan et de la réduction des capacités internes d’USAID. En 2015, les 20 principaux signataires de contrats avec USAID ont ainsi perçu 4,8 milliards de dollars, dont 25 % seulement étaient alloués à des ONG ». Reconnaissant que la collaboration des ONG avec ces CPD (qui leur sous-traitent souvent des pans d’activités) permet aux premières d’accéder « à des financements d’envergure, pluriannuels et portant sur plusieurs pays », l’auteure insiste sur les indispensables points de vigilance. Et l’éthique est en première ligne : « L’ONG doit ainsi poser ses conditions sur des questions spécifiques, comme le recours à des sociétés privées de sécurité ou à des escortes armées ; la négociation avec des parties engagées dans le conflit ; l’intervention dans des zones où le bailleur peut avoir des intérêts autres qu’humanitaires, ou encore les exigences posées par certains bailleurs en matière de lutte contre le terrorisme. » Si l’exemple vient encore essentiellement des États-Unis où « les liens sont clairement assumés par les CPD qui reconnaissent poursuivre les objectifs de la politique étrangère américaine », il convient de s’interroger sur les signaux – plus ou moins faibles – d’un éventuel décalque en Europe et notamment en France.
Le récent exemple du groupe français Lafarge, soupçonné d’avoir payé l’État islamique afin de pouvoir continuer ses activités en Syrie durant l’actuel conflit, est de ceux-là[1]Enquête de l’émission Secret d’info, France Inter, 14 octobre 2017, www.franceinter.fr/emissions/secrets-d-info/secrets-d-info-14-octobre-2017. L’affaire pourrait ne relever que des « contestables » pratiques d’entreprises et ne pas interpeller les ONG si Lafarge n’était signataire – avec quatre autres multinationales françaises – d’un accord avec le ministère français des Affaires étrangères afin de créer des synergies entre les moyens privés et publics. Signé en août 2014, cet accord prévoit en effet que, en cas de crise humanitaire, les entreprises concernées mettent à disposition de l’État français leurs moyens logistiques, tandis que ce dernier leur ouvre ses réseaux diplomatiques pour faciliter leurs gains de marchés. L’effet de confusion pour les ONG françaises engagées sur le terrain peut être, on l’imagine, catastrophique.
Ce à quoi nous invite cette sélection d’articles, c’est à prendre la mesure du fait que l’arrivée des entreprises dans l’humanitaire n’est pas simple opportunité de financements nouveaux. C’est un sujet à la frontière de la sociologie historique, de l’éthique et de la géopolitique. La première nous enseigne que ce sont notamment les ONG qui en ont appelé à la responsabilité sociale des entreprises – et qu’elles seraient donc malvenues de les renvoyer dans leurs cordes. La deuxième impose que l’éthique qui s’applique aux ONG soit également appropriée par les entreprises. Et la dernière nous rappelle que l’État ne saurait être absent de cette réflexion.
Parce que ce dossier n’épuise pas ce sujet essentiel, notre prochain numéro – à paraître en mars prochain – prolongera cette réflexion et ce dialogue en questionnant notamment le rôle que l’État, garant de l’intérêt général et arbitre des intérêts particuliers, peut jouer dans ce débat, notamment pour y promouvoir une éthique partagée. La solidarité internationale ne relève-t-elle pas, en effet, de l’intérêt général.
.
ISBN de l’article (HTML): 978-2-37704-268-5